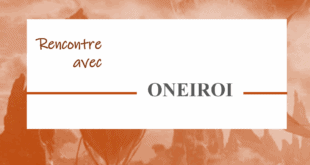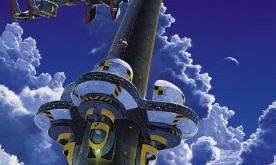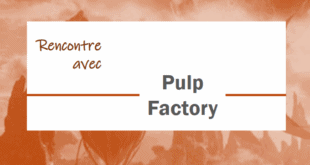Entretien réalisé lors des Utopiales 2024 par Agathe Tournois & David Soulayrol
Présences d’Esprits : Comment vois-tu la place de ta maison d’édition dans le paysage SFFF ?
David Meulemans : Nous sommes une maison d’édition indépendante. Nous n’appartenons pas à un groupe ce qui signifie que nous sommes libres de publier ce que nous voulons. Cela nous permet parfois de prendre des risques en choisissant des textes un peu en marge des tendances. Mon objectif est que ma maison d’édition soit accessible et grand public. 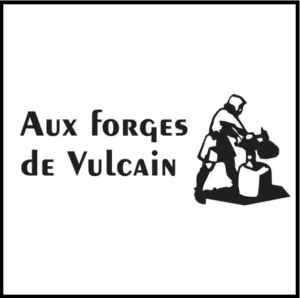 Nous recherchons des textes avec une certaine forme d’originalité. La moitié de notre catalogue est liée à l’imaginaire, l’autre moitié est de la littérature générale, cela donne une caractéristique assez marquante à notre maison. Nous sortons seulement cinq titres d’imaginaire par an, dont des traductions, qui se répartissent à égalité entre science-fiction, fantasy et fantastique. Ce qui fait en moyenne, deux titres de SF francophone par an, sachant que cette année est très exceptionnelle, parce qu’on en a eu quatre. Il y a deux ans, j’avais déclaré aux auteurs qu’on n’avait pas de textes de SF française dans le catalogue et ils m’ont soumis des récits en conséquence. Mais, concrètement, nous publions peu de SF et nous sommes un peu en marge avec cette hybridation entre littérature de l’imaginaire et littérature générale.
Nous recherchons des textes avec une certaine forme d’originalité. La moitié de notre catalogue est liée à l’imaginaire, l’autre moitié est de la littérature générale, cela donne une caractéristique assez marquante à notre maison. Nous sortons seulement cinq titres d’imaginaire par an, dont des traductions, qui se répartissent à égalité entre science-fiction, fantasy et fantastique. Ce qui fait en moyenne, deux titres de SF francophone par an, sachant que cette année est très exceptionnelle, parce qu’on en a eu quatre. Il y a deux ans, j’avais déclaré aux auteurs qu’on n’avait pas de textes de SF française dans le catalogue et ils m’ont soumis des récits en conséquence. Mais, concrètement, nous publions peu de SF et nous sommes un peu en marge avec cette hybridation entre littérature de l’imaginaire et littérature générale.
PdE : Vous souhaitez tisser un lien entre la littérature blanche et l’imaginaire ?
M. : Pas nécessairement. Je pense qu’une partie des littératures de genre sont du divertissement pur. Notre idée est d’articuler le divertissement, le travail sur la langue et parfois le propos (pas nécessairement le propos politique, mais aussi social). Même si le divertissement est important, ce n’est pas le seul critère de choix. Cela étant, c’est un trait commun aux littératures de genre et à l’imaginaire : ces deux rayons sont structurés par une tension entre divertissement et art. Il faut un peu des deux à chaque fois.
PdE : Trouve-t-on des collections particulières dans votre catalogue ?
M. : Non, il n’y a pas de collections. Nous n’avons qu’une seule division : la littérature générale d’un côté et la SFFF de l’autre. Je pense que c’est une particularité éditoriale que tout le monde ne voit pas. Nous avons la même maquette pour la littérature générale et pour l’imaginaire, ce qui manifeste la volonté d’établir un lien entre les deux. Depuis une dizaine d’années, ce lien s’est renforcé. Nous n’avons rien inventé de ce côté-là, pas mal de maisons font ces ponts. Soit elles vont rester dans la SF classique et lors de la rentrée littéraire avoir des difficultés pour placer leurs textes en librairie au rayon de littérature générale, soit on a des éditeurs de littérature générale classique qui vont publier des histoires un peu plus imaginatives qui n’atterriront pas pour autant dans les espaces consacrés à la littérature de l’imaginaire.

Pour nous, quand nos livres sortent, la littérature générale va aller au rayon littérature générale. L’imaginaire va aller au rayon imaginaire, mais la maquette identique peut générer des interactions et le libraire va parfois avoir envie de faire une table à mi-chemin des deux rayons. Dans quelques librairies en France, tout le rayon littérature n’est qu’un seul immense rayon. Par exemple, chez Le Failler à Rennes, tout le rez-de-chaussée est consacré à la littérature au sens large. Cela part de la poésie, ça finit au polar, et ce sont toutes les couleurs de la littérature. Des littératures différentes, mais toujours de la littérature. Cela permet plus d’interactions, plutôt que le découpage qui va consister à dire, au premier étage, c’est la littérature de genre, au rez-de-chaussée, les littératures sérieuses. On voit cette évolution depuis dix ans. On observe également que les lecteurs de moins de trente-cinq ans apprécient cette interaction, parce qu’ils ont commencé à lire avec Harry Potter et en arrivant à l’âge adulte, ils conservent un attrait pour l’imaginaire, ou sinon, les lecteurs viennent de la littérature « sérieuse » et se rendent compte que celle-ci est un peu facile, passive parfois, et que l’imaginaire propose quelque chose d’exaltant, et ils veulent retrouver ça. On a aussi des gens qui font le choix inverse.
Initialement, au 19e siècle, la littérature était plutôt une littérature de l’imaginaire. Et à la fin du 19e siècle, une littérature naturaliste, destinée à parler des ouvriers aux ouvriers s’est développée. En France, le terme de « littérature générale » est quasiment un homonyme de « littérature réaliste », ce qui n’est pas le cas dans les autres pays. Au 20e siècle, une grande partie de la littérature générale est devenue une littérature de grande consommation, avec pour discours : « Le monde est ainsi, il faut l’appréhender, l’aimer tel qu’il est. » Fondamentalement, il s’agit d’une littérature réaliste, et l’imaginaire est en partie une littérature du possible, dans laquelle les rapports entre humains pourraient être différents. J’ai commencé par lire de la Fantasy avec Le Seigneur des anneaux, puis Donjons et Dragons, puis Le Hobbit, dans cet ordre-là, puis après la SF avec Dune à quatorze ans, puis K. Le Guin à seize ans : elle m’a vraiment ouvert les yeux sur tout un monde de possibles. La littérature générale ne fait pas vraiment ce travail. Les éditeurs de ce genre n’ont pas intérêt à renverser l’organisation sociale, car ils occupent une position assez confortable. Les récits de K. Le Guin ont le potentiel pour déranger l’organisation sociale. La littérature de l’imaginaire est géniale pour son côté divertissant, mais elle a aussi des choses à dire, on a tendance à croire que ces deux fonctions ne sont pas superposables, alors qu’il existe des tonnes de romans dans lesquels c’est superposable. Le Seigneur des anneaux, au-delà du divertissement, raconte plein de choses sur l’amitié, le courage, et il est porteur de valeurs.
PdE : Comment es-tu devenu éditeur ?
M. : J’ai toujours eu une passion pour le livre, pas seulement la lecture, mais aussi comment le fabriquer.

J’ai enseigné la philo à la fac et sur mon temps libre j’ai travaillé pour un éditeur dans le scolaire, autour de la philo, et puis j’ai réalisé que l’édition m’intéressait plus que l’enseignement. J’ai alors basculé en créant une maison d’édition : Les Forges de Vulcain.
David Meulemans, fondateur des éditions Aux Forges de Vulcain
PdE : Combien de salariés êtes-vous ?
M. : Nous sommes deux permanents. Selon les projets, l’équipe s’étoffe avec une attachée de presse, un attaché de librairie et d’autres collaborateurs en fonction des besoins. Nous sommes en sous-effectif permanent, mais ça nous aide, car le jour où les ventes baissent (ce qui arrive toujours), on peut tenir. Les ventes de livres, c’est du yoyo. Beaucoup de maisons indépendantes ont subi une à deux saisons de mauvaises ventes et ont dû mettre la clé sous la porte.
PdE : Combien de livres la maison publie-t-elle par an ? À quel tirage ?
M. : Notre maison date de 2010, et j’ai compris en 2016-2017 qu’il fallait faire moins de livres pour mieux les accompagner. Il est plus intéressant de publier un livre à quatre mille exemplaires que deux livres à deux mille. L’idéal serait de sortir dix livres par an, mais on n’arrive pas à descendre à dix.
Nous atteignons régulièrement quatre-mille ventes pour un ouvrage, mais on a aussi profité, comme beaucoup de maisons depuis 15 ans, du fait de pouvoir faire des impressions par tranches de mille pour les réimpressions. J’ai appris l’édition sur le tas, en lisant des manuels, datés du début des années 2000. À cette époque, il fallait imprimer des gros tirages au début, car cela coûtait très cher de réimprimer. Ce n’est plus le cas.
Nous avons une bonne assise de lecteurs, nous vendons rarement des livres en dessous de mille exemplaires. En deçà de mille, c’est difficile de faire un deuxième livre : les diffuseurs-distributeurs vont être sceptiques sur l’opportunité de poursuivre le travail. La plupart de nos titres s’écoulent entre mille et deux-mille exemplaires. Nous avons des titres à quatre-mille, et puis nous avons quelques titres, peu nombreux, largement au-dessus. Par exemple, en grand format, nous avons un best-seller à quarante mille : L’Homme-dé de Luke Rhinehart, traduit par Francis Guévremont. Mais ce n’est pas un roman d’imaginaire. C’est un classique qui date de 1971 dont on a récupéré les droits en 2018. Nous sommes à trente-deux mille pour Le soldat désaccordé, toujours en littérature générale. En imaginaire francophone grand format, on atteint douze à treize mille exemplaires pour le premier volume de La Tour de Garde, notre meilleur score imaginaire en grand format. Ce qui est très appréciable avec les titres de l’imaginaire, c’est que les gens sont attachés au grand format, alors qu’en général le format poche tue les ventes grand format.

PdE : Comment se déroule la distribution ?
M. : Notre distributeur est Média-Participation, le troisième distributeur de livres en France, après Hachette et Interforum. Nous sommes distribués en théorie dans le monde entier, mais en pratique en France, Belgique, Québec et dans quelques librairies francophones de l’étranger. Ce sont les commerciaux qui placent en librairie, et là, ça va dépendre de leurs relations avec les libraires, on a encore de la conquête à faire. Certains libraires nous soutiennent beaucoup, mais il y a encore aujourd’hui des librairies qui ne nous connaissent pas.
Le développement des rayons imaginaires dans les librairies généralistes est une évolution assez récente qui nous est favorable. De plus en plus de libraires se disent : « Je veux mon rayon imaginaire ». La difficulté pour eux est que, parfois, les lecteurs sont plus connaisseurs qu’eux.
PdE : Comment sont sélectionnés les titres ?
M. : La part d’auteurs et autrices francophones est toujours de 50 %. Nous cherchons aussi à avoir 50 % d’auteurs et 50 % d’autrices.
PdE : Et pour les primo auteurs ?
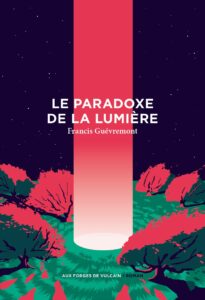 M. : Comme nous suivons nos auteurs sur la durée, nous avons peu de place pour des nouveaux auteurs. Nous n’avons pas prévu de pousser les murs, donc chaque année, on accueille un (ou deux) nouvel entrant. Un seul pour 2024, Francis Guévremont, en SF, avec Le Paradoxe de la Lumière, mais, en 2025, on aura trois nouveaux auteurs.
M. : Comme nous suivons nos auteurs sur la durée, nous avons peu de place pour des nouveaux auteurs. Nous n’avons pas prévu de pousser les murs, donc chaque année, on accueille un (ou deux) nouvel entrant. Un seul pour 2024, Francis Guévremont, en SF, avec Le Paradoxe de la Lumière, mais, en 2025, on aura trois nouveaux auteurs.
PdE : Comment se passe la sélection des textes ?
M. : Très souvent, les romans arrivent par la boîte à manuscrits. Francis Guévremont est un mauvais exemple parce que je le connais depuis quinze ans, c’est un très bon traducteur et cela fait des années que je lui dis qu’il devrait écrire. Julia Colin en imaginaire (Avant la Forêt), Alexandra Koszelyk (Pages volées) en littérature générale, sont issues de la boite à manuscrits qui est intégralement numérique.
Il peut aussi m’arriver d’aller chercher des manuscrits de romans, de me dire : « J’aime bien les nouvelles de telle personne ». (Je ne publie pas de nouvelles, car je ne sais pas très bien le faire).
PdE : Combien de manuscrits recevez-vous ?
M. : On reçoit un peu plus de 4 000 manuscrits par an en numérique. Sur les 4 000, il y en a 90 % qui sont sans aucun intérêt pour nous : de l’album jeunesse, de l’érotique, des souvenirs de voyage, que des genres qu’on ne publie pas. Beaucoup de gens ont récupéré notre email dans des listes sur le net, et nous envoient leur projet sans connaitre notre ligne éditoriale. C’est moi qui gère la boite à manuscrits, les gens ne mesurent pas le temps que ça prend ! Quand tu lis trente manuscrits fantaisistes, ton acuité, quand tu arrives sur le bon, est un peu émoussée…
Entre éditeurs, on se demande souvent si cela ne vaudrait pas le coup de créer un site internet qui expliquerait la démarche de soumission. On se rend compte que les manuscrits reçus et qu’on publie, globalement, sont très homogènes sociologiquement. Il y a des pans entiers de la population française qui n’ont pas accès à l’édition, qui n’y pensent même pas parce qu’il leur manque les connaissances pour aller vers l’édition, et la question est comment on va les chercher, comment on va trouver le moyen d’établir les ponts avec ces autres populations ? Par exemple, je regarde ce qui se passe sur Wattpad. Parfois on tombe sur un auteur prometteur. Ce travail de veille pour détecter des nouveaux auteurs à publier est très gourmand en temps.

PdE : Avez-vous un comité de lecture ? Comment se passe la sélection des textes ?
M. : On ne lit pas tous les manuscrits en entier, mais on les examine tous. Si, assez vite, on a du mal à se projeter dans le livre fini, on arrête notre lecture. Certains textes sont très faciles à éliminer, d’autres moins, et on laisse sûrement passer des récits qui auraient pu être bien chez nous. C’est moi qui ouvre les textes et fais une sélection de cinquante à cent manuscrits par an. Et là, on les lit en entier, et on en retient cinq à dix. À ce stade, on va contacter les auteurs pour les rencontrer. On les prévient que ce n’est pas un entretien d’embauche. On souhaite les rencontrer pour connaitre leur objectif en tant qu’auteur. Après cette première rencontre, si j’ai l’impression que la personne comprend bien ce qu’on fait et que j’ai bien compris ce que la personne fait (on a parfois une interprétation faussée en lisant un texte), je leur propose un contrat de publication classique.
PdE : Comment se passent les corrections éditoriales ?
M. : C’est très variable. Certains des textes sont assez près de la publication et d’autres en sont très loin, ce qui implique que l’auteur va beaucoup réécrire. Nous discutons ensemble des points à retravailler, par exemple : « Est-ce que tu es sûr de l’intérêt de ces deux personnages, il ne faudrait pas les fusionner ? » Les corrections peuvent durer jusqu’à dix-huit mois pour certains textes. Nous allons aussi rediscuter du titre. Parce que le titre implique l’éditeur, nous le choisissons ensemble. Nous travaillons sur la couverture et puis après ça part chez la correctrice. Et, petit à petit, le jour de sortie approche.
PdE : Tout à l’heure, vous disiez être deux permanents et que vous recrutiez des free-lances si besoin.
M. : Quand le besoin se fait sentir, nous recrutons des freelances. Quand on sait qu’on titre va avoir un fort potentiel presse, on engage un ou une attachée de presse sur ce livre. On garde pour nous le travail édito.
PdE : Quels sont les prochains titres ?
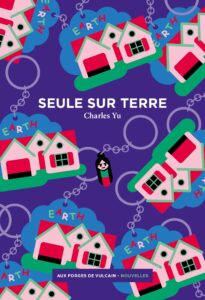
M. : En imaginaire, le retour de Pierre Raufast. C’est un auteur qui vient de la littérature générale et qui a écrit La trilogie baryonique (SF). Il revient pour un 4e volume qui se passe 700 ans après les trois premiers. C’est son meilleur roman, et je ne dis pas ça parce que le nouveau roman d’un auteur est toujours son meilleur. Là, c’est vraiment exceptionnel !
Nous travaillons aussi au nouveau titre de Rivers Solomon. Cela s’appelle Maison modèle, un hommage à Shirley Jackson.
L’avantage de suivre des auteurs au fil du temps est de les voir aboutir à un texte qui n’aurait pas pu être leur première œuvre. Une histoire qui nécessite d’avoir atteint une certaine connaissance de ce qu’on veut écrire, une connaissance aussi de son public.
PdE : D’autres projets éditoriaux ?
M. : Nous avions envisagé de publier de la jeunesse, mais je ne suis pas assez aguerri pour le faire. Nous avons aussi réfléchi à publier de la BD, mais les enjeux financiers sont hors de notre portée. Un dessinateur doit être payé un an à deux ans pendant qu’il dessine.
PdE : Certaines maisons d’édition s’associent, par exemple, à Dargaud.
M. : Oui, on peut vendre nos droits, mais on ne fera pas de la BD en interne. Nous allons cependant réactiver la collection Essais. On en publiait beaucoup dans le passé. Au début de la maison, on était à 50 %. Là, on est plus qu’à 10 %. Nous souhaitons publier un à deux essais par an dans l’idée d’atteindre jusqu’à quatre titres par an d’ici à 2027. Notre objectif est de sortir des livres qui donnent envie aux lecteurs et lectrices en France, dans un monde étouffé par la montée de l’extrême-droite, par les tensions nationalistes et le dérèglement climatique, de retrouver les valeurs de l’humanisme, de l’entraide, du souci d’autrui et de défense de l’environnement.
Les éditions Aux Forges de Vulcain sont situées à Bussy Saint-Martin Éditions Aux Forges de vulcain
 Club Présences d'Esprits Tous les mondes de l'imaginaire
Club Présences d'Esprits Tous les mondes de l'imaginaire